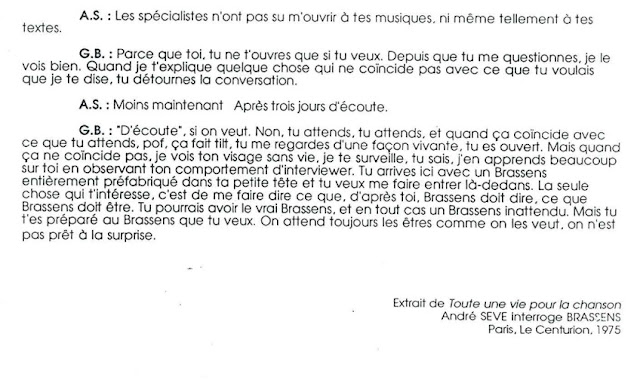Etre en contact avec la liberté de la dimension religieuse dans l'existence.
jeudi 24 juillet 2025
Rester éveillé avec Christiane Singer
mercredi 4 juin 2025
Zazen n'est pas une fuite
5 minutes avec Jacques Castermane
Être à l'écoute !
lundi 30 décembre 2024
Un voyage avec Matthieu Ricard
RENCONTRE - Ce samedi 28 décembre, Ushuaïa TV a proposé un numéro inédit du magazine Les voyageurs solidaires consacré à Matthieu Ricard. Devenu moine bouddhiste, interprète français du dalaï-lama, auteur et photographe à succès, il a fondé Karuna-Shechen, une ONG laïque et apolitique, pour lutter contre la pauvreté.
Entre une retraite en Dordogne et un voyage au Bhoutan, Matthieu Ricard nous reçoit chez son cousin à Paris pour parler de voyages et d’altruisme. Des amies passent, des collaborateurs s’affairent dans la pièce voisine autour d’un projet de film et d’un livre à paraître. Une ruche créative, baignée de joie et de bonne humeur.
Matthieu Ricard. - Grâce à ma famille, j’ai eu la chance d’être confronté à des gens passionnants qui venaient régulièrement à la maison : des prix Nobel, intellectuels, artistes, scientifiques, explorateurs… J’admirais leurs talents, mais je n’avais pas forcément envie de leur ressembler en tant qu’être humain. Et puis un jour, à 20 ans, j’ai vu Le Message des Tibétains, le documentaire d’Arnaud Desjardins. Il avait filmé des maîtres spirituels qui avaient fui l’invasion du Tibet. J’avais l’impression de voir vingt Socrate, vingt saint François d’Assise, vivant aujourd’hui. J’ai tout de suite décidé de partir en Inde, en 1967. Arnaud m’a alors conseillé d’aller rendre visite à l’un de ces maîtres qui l’avait particulièrement impressionné, Kangyur Rimpoché. Je suis donc parti pendant les vacances universitaires le voir à Darjeeling. C’était tellement extraordinaire ! Une montagne de sagesse, de bienveillance, de simplicité. J’ai pensé : je suis arrivé à destination, à l’endroit depuis lequel je peux faire le voyage de toute une vie. J’ai dû rentrer à Paris pour finir mes études, soutenir ma thèse de doctorat en génétique cellulaire. J’ai fait six allers-retours, et fin 1972, j’ai pris un aller simple, me suis installé dans un petit ermitage auprès de mon maître spirituel et me suis dit : la vraie recherche commence maintenant ! Comme disait le poète Henri Michaux, « si on va en Inde sans une quête spirituelle, on est juste la proie des moustiques ».
L’Inde est-il un pays fascinant mais qui peut faire peur ?
Il y a des personnes qui vous disent « moi je ne peux pas aller en Inde, c’est trop dur, il y a trop de misère ». Pourtant, quand on voyage dans les campagnes indiennes, c’est très beau et émouvant. S’émerveiller devant la beauté de la nature ou le regard d’un enfant, ça nous sort du cocon de l’individualisme exacerbé. Voyez la façon dont les villages sont solidaires, l’organisation de la vie communautaire ! Tout le monde aide à la moisson, à réparer un toit… Vous savez, j’ai beaucoup vécu dans les quartiers pauvres de Delhi. Les conducteurs de rickshaws qui viennent des campagnes n’ont pas les moyens de se loger, ils dorment sur leurs sièges dans la rue. Eh bien le soir, ils se réunissent en cercle, font un feu avec des vieux cartons, et chantent, s’amusent, rigolent… Il n’y a pas ce malaise que l’on voit dans les sociétés occidentales où la consommation d’anxiolytiques et le nombre de suicides des jeunes ne cesse d’augmenter.
Que voulez-vous dire ?
On peut penser que je suis naïf, mais ce comportement a été étudié, il s’appelle le paradoxe des pauvres heureux. Évidemment cela ne veut pas dire qu’il faut les laisser pauvres, ce serait inconvenant. Il faut bien entendu les aider à sortir de la pauvreté et leur apporter une assistance médicale, les éduquer s’ils le souhaitent… Mais ils vivent avec une certaine insouciance, sans être préoccupés par l’ambition, la soif de consommation, de statut social. Mettre tous nos atouts dans le développement matériel, ce n’est pas ce qui nous rend épanoui dans l’existence. Une fois que vous avez le minimum pour vivre raisonnablement, sans devoir être dans l’angoisse chaque fin de mois, doubler ou tripler vos revenus ne vous rend pas plus heureux. C’est le fameux paradoxe d’Easterlin, qui a bien été étudié. Un proverbe tibétain dit : « Savoir se contenter, c’est tenir un trésor dans le creux de sa main. » Quand vous avez cinq milliards à dépenser pour aller cinq minutes dans l’espace avec vos copains comme M. Jeff Bezos alors qu’avec cette somme vous pouvez mettre tous les enfants qui ne sont pas scolarisés à l’école, c’est indécent. Il faut absolument sortir de ses intérêts personnels immédiats pour contribuer au bien commun. Développer la voie du « care » à côté de celle de la raison. On ne peut plus dire aujourd’hui « I don’t care », pour la pauvreté au sein de la richesse, pour le sort des générations futures… ça ne passe plus !
Quand avez-vous commencé à aider les autres ?
Tout est parti du voyage initial qui m’a mené à vivre en Inde, au Népal, au Bhoutan… et m’a permis de voir tout ce qui pouvait être fait pour aider. Mais je n’avais aucun moyen et vivais avec l’équivalent de cinquante euros par mois. Puis un éditeur m’a proposé de faire un livre d’entretiens avec mon père Jean-François Revel. Cet ouvrage, Le Moine et le Philosophe, a été un grand succès. Avec les droits d’auteur, je n’allais pas construire une piscine dans l’Himalaya ni rouler en Ferrari sur les chemins de pierre ! J’ai donc donné tout l’argent de ce livre, et des suivants, à des projets humanitaires et ai créé la fondation Karuna-Shechen consacrée à des programmes de lutte contre la pauvreté. Elle fêtera ses 25 ans l’an prochain. Aujourd’hui, Karuna-Shechen vient en aide à 500.000 personnes directement et 1 million indirectement chaque année. Nous avons commencé comme des Indiana Jones au Tibet, où nous avons construit vingt-cinq dispensaires et autant d’écoles, ainsi que dix-huit ponts. Bref, tout cela est parti d’un voyage de découverte qui s’est transformé en voyage altruiste.
Comment définissez-vous l’altruisme ?
L’altruisme est défini comme l’intention que vous avez maintenant, pas forcément tout le temps (on n’est pas altruiste à tout moment dans toutes les situations) d’accomplir le bien d’autrui ou de soulager sa souffrance. La finalité n’est pas de recevoir des louanges ou d’être fier de soi. Cette intention doit être purement altruiste, sans calcul. Vous n’allez pas aider une vieille dame pendant un an dans l’espoir d’avoir son héritage, par exemple. Le but est d’être au service d’autrui. Et généralement on se sent bien soi-même en faisant le bien des autres, car cela reflète notre nature profonde, mais il ne faut évidemment pas le faire dans ce but, même si, comme disait Coluche, « il n’y a pas de mal à se faire du bien ». Un milliardaire me disait un jour : je donne à des associations humanitaires car ça me fait du bien ! Ça, c’est le « warm glow » anglo-saxon, mais certainement pas l’altruisme véritable. J’ai écrit un livre, Plaidoyer pour l’altruisme, de 800 pages et je projette de faire L’altruisme en action, une version courte de 100 pages, pour évoquer tout ce qui peut être mis en pratique de manière pragmatique pour soulager les souffrances et apporter du bien-être à autrui. J’évoquerai également les développements récents comme le mouvement de l’altruisme efficace.
Avons-nous une prédisposition à l’altruisme ?
Si on se sent mieux quand on est altruiste cela indique qu’au fond, en tant qu’animal social, les humains sont profondément coopérateurs. Les recherches en psychologie comportementale, dans plusieurs universités, ont montré que les jeunes enfants de moins de 5 ans sont des coopérateurs inconditionnels et préfèrent les gens qui se comportent avec bienveillance avec d’autres personnes, contredisant ainsi ce qu’affirmaient Freud et Piaget. Nous avons donc une prédisposition plus forte à l’altruisme. Certes, on peut devenir un psychopathe, ou un dictateur sanguinaire, mais la plupart des huit milliards d’êtres humains, la majeure partie du temps, se comportent de manière décente les uns envers les autres. Ça ne se remarque pas car, quand tout va bien, on n’en parle pas. C’est ce que j’ai appelé la « banalité du bien. »
Comment être une bonne personne sans se faire marcher sur les pieds ?
En étant ferme, mais sans malveillance, sans s’emporter, sans escalade de la violence. Être altruiste ne signifie pas être un paillasson, ni vivre dans un monde de bisounours, mais avoir toujours à l’esprit l’accomplissement du bien d’autrui.
Est-ce que les voyages développent l’altruisme ?
Absolument. Le voyage peut développer l’altruisme et d’autres qualités humaines comme la résilience, la paix intérieure, la force de l’âme et beaucoup d’autres. Les qualités intérieures, c’est ce qui donne du sens à notre existence. Les cultiver, c’est l’affaire d’une vie, mais c’est la chose la plus belle que l’on puisse faire. Comme disait Aristote, « on devient vertueux en pratiquant la vertu ». Le voyage nous ouvre les yeux sur notre humanité commune.
En voyage, nous avons tous été confrontés un jour à la grande pauvreté, une misère abyssale… Comment se comporter humainement sans souffrir soi-même de la peine des autres ?
C’est le problème de la détresse empathique. L’empathie affective nous mène à souffrir de la souffrance de l’autre. C’est l’effet que les émotions de l’autre ont sur vous. Elle est importante car elle vous permet de comprendre la situation de l’autre. Mais elle épuise, et peut conduire au burn-out. En revanche, la compassion est entièrement tournée vers l’autre, c’est apporter une bienveillance inconditionnelle à la souffrance de l’autre. Un flot d’amour. Un baume. C’est le bon cœur, la chaleur humaine. La compassion est un antidote direct à la détresse empathique. Elle régénère nos forces. Quand un médecin intervient sur un champ de bataille, il ne se pose pas de question, il agit.
Pourquoi vos portraits photographiques montrent-ils toujours des êtres humains souriants ?
Je n’ai jamais pu faire de photos sur la déchéance humaine. C’est un choix que j’assume. À travers la photo, j’essaie de redonner confiance en la nature humaine.
source : Par Marie-Angélique Ozanne, pour Le Figaro Voyage
association de Matthieu Ricard : Karuna-shechen.org
----------------
mardi 24 décembre 2024
Nature et prière
Gilles Farcet : « Depuis ma petite enfance, j’ai été happée par la recherche de l’Absolu et cela involontairement », écrivez-vous (Un itinéraire, page 10). Qu’est-ce qu’être « happée par la recherche de l’absolu » ?
Marie-Madeleine Davy : Dans ma petite enfance, la nature m’a ouvert les yeux. J’ai toujours habité Paris, mais je passais deux mois par an à la campagne, chez ma grand-mère, dans une maison dont je devais par la suite hériter. Il y avait là un très grand jardin, et l’Absolu, me semble-t-il, m’a été communiqué par la nature. J’éprouvais le sentiment de pouvoir parler avec les arbres, les fleurs, l’herbe, et je jouissais d’une grande familiarité avec les animaux (papillons, libellules, moustiques même). Les oiseaux venaient près de moi, et mon meilleur gourou a été un corbeau, que je nommais Elie. Un jour, ce corbeau est venu se poser sur ma tête. Et il me semblait converser avec lui. C’était un ami ; un ami intime, profond. Le matin, lorsque j’étais paresseuse, il venait taper au carreau afin que je lui donne quelques graines. Oui, mon plus grand gourou, ce fut lui…
Gilles Farcet : Vous arrive-t-il de prier ?
Marie-Madeleine Davy : Oui. Mais pas avec des prières toutes faites. Je n’en ai pas l’usage. J’invoque, j’appelle. Je peux crier au secours, ou encore remercier. Voyez-vous, la vie est une prière si elle est ordonnée dans le face à face. La plupart du temps, nous ne sommes pas sincères, nous biaisons et n’obtenons donc pas de réponse. Mais aucun appel authentique ne résonne dans le désert. La prière, pour moi, consiste à sourire à ce qui est venu, à ce qui vient, ce qui viendra. Elle est avant tout acceptation profonde. L’épreuve débouche sur une aurore.
---------------
mardi 19 mars 2024
Communication autoritaire
Quid du nouvel outil « vocal » beaucoup utilisé par la jeune génération ?
Le fait de parler à l’autre oralement supposait jusqu’à présent au moins un « maintenant », un présent en commun (pas forcément un « ici » depuis que le téléphone existe). La conversation nécessitait une forme de synchronisation. Or le vocal est un mode de communication orale sans synchronisation, c’est la première fois que cela apparaît dans l’histoire de l’humanité.
C’est un changement anthropologique ?
Bien sûr. Aujourd’hui, le message est antérieur à l’acte de communication. Quelqu’un est seul ; il détient une information ; il la délivre ; la seule chose importante, c’est de s’assurer que l’autre l’a bien reçue. À l’inverse, dans les dialogues de Platon, on crée des vérités par l’échange et le dialogue. Il n’y a pas de message préexistant. Socrate dit : je sais que je ne sais pas. Le questionnement, l’échange nous conduisent quelque part. On vit un voyage à deux vers le message.
Dans notre paradigme actuel, le message est antérieur à la rencontre. C’est quand même moins intéressant ! La rencontre ne va pas me faire changer ni m’amener à penser, créer, ressentir des sentiments nouveaux. On ne se laisse plus bousculer par la rencontre : je veux juste que les autres entendent ce que j’ai à dire et qu’ils l’acceptent. Dans l’acte de communication, il y a désormais une forme d’autoritarisme.
Alexandre Lacroix, directeur de la revue Philosophie magazine
source : La Vie magazine
-----------------------
mercredi 6 mars 2024
Acceptation du monde
Dans un monde où la quête du bonheur peut devenir une injonction, le philosophe Alexandre Jollien nous offre une perspective rafraîchissante, privilégiant la joie et l’acceptation du monde tel qu’il est. À travers son expérience personnelle et sa réflexion spirituelle, il nous guide vers une compréhension plus profonde de l’harmonie intérieure.
L’Éventail – Comment définiriez-vous le bonheur ?
Alexandre Jollien – Je me méfie un peu de la notion du bonheur qui, aujourd’hui, tend à devenir une injonction qui jette pas mal de monde sur le bas-côté et qui culpabilise ceux qui n’y arrivent pas. Je préfère parler de joie, d’adhésion au monde. Tordons le cou aux préjugés qui associent le bonheur à la possession. Il s’agit d’un état, d’une activité de l’âme et du cœur, une sorte de béatitude intérieure qui, très humblement, s’incarne dans un mode de vie. Le grand défi, c’est rejoindre, comme diraient les bouddhistes, la nature de Bouddha. Au fond, il n’y a rien à ajouter en soi. Nous sommes déjà équipés de tout ce qu’il faut pour être heureux. En un mot, se libérer et laisser circuler la vie.
– Vous parlez souvent de la spiritualité comme d’un chemin vers le bonheur. Pouvez-vous expliquer en quoi la spiritualité influence votre perception du bonheur ?
– Le bonheur est avant tout un exercice, une activité de l’être. Rien ne le contrarie plus que l’immobilité, le statique. Comme la vie, il est mouvant, il évolue. À chaque étape, nous sommes appelés à pratiquer les exercices spirituels. Les philosophes antiques se percevaient comme des “progressants”. Chaque jour, ils devaient déraciner de leur âme tout ce qui appesantit, plombe, afin d’évoluer vers une vie vertueuse. À chaque instant, comme dit le zen, nous mourons et nous renaissons. L’important est de composer avec les forces du jour, ne plus être ligoté à des objectifs et s’ouvrir à une vie sans pourquoi. Si nous limitons le bonheur à un état précis et matériel, nul doute que nous allons passer à côté de l’essentiel.
– Quelles pratiques quotidiennes recommanderiez-vous pour cultiver le bonheur et la pleine conscience dans nos vies trépidantes ?
– Dans ma petite pharmacopée personnelle, j’ai quelques ingrédients, quelques potions aptes à me mettre en joie. D’abord, le matin, avec Nietzsche. Dans Humain, trop humain, le philosophe nous conseille de nous lever en ayant à l’esprit et dans le cœur le désir de faire plaisir à quelqu’un ce jour-là. Geste éminemment concret qui nous arrache au narcissisme pour nous inciter à nous donner aux autres, au monde. La pratique du zen et la méditation ne sont pas des baguettes magiques qui nous changeraient illico, mais plutôt un art qui nous invite à descendre au fond du fond, comme dirait maître Eckhart, pour trouver une joie qui nous précède. Ce déménagement intérieur permet de regarder, sans les juger, les émotions, les passions qui nous traversent. Fabuleux outil ! Un ingrédient majeur, c’est aussi le lien à l’autre. Un lien désintéressé, gratuit, donné. En allant au lit, j’ai souvent en tête les mots de Sénèque qui proposait que l’on se demande, à cette occasion, quels progrès nous avons accomplis dans la journée. Très concrètement, dans une société au rythme trépidant, on peut aussi, à tout moment, faire des retraites intérieures. Apprenons à ralentir : à une caisse de supermarché, en attendant le train… Retourner au fond du fond, où nous avons, comme dit Jacques Castermane, infiniment le temps. Voir qu’il y a un immense gouffre entre ce après quoi nous courons et ce que nous désirons réellement. Au fond, l’art de la joie et du bonheur est infiniment plus concret que nous ne le croyons, et les philosophes l’ont bien perçu quand ils nous invitent à adopter un art de vivre, à pratiquer.
– Si vous aviez un message à partager avec ceux qui cherchent le bonheur mais qui se sentent perdus ou découragés, quel serait-il ?
– Lorsque je suis dans la panade, lorsque le désespoir me guette, je me dis souvent qu’il s’agit de mettre la main à la pâte, car rien ne plombe plus que l’immobilisme, la résignation, le fatalisme. Au fond, j’essaie toujours d’inscrire ma vie dans une dynamique et de m’interroger. Quel progrès puis-je accomplir aujourd’hui ? Jusqu’à la fin de la vie, même un mourant peut progresser. Il ne faut jamais, non plus, hésiter à demander de l’aide. De même que dans l’aviation il y a des protocoles en cas de pépins, je me suis aussi fait un protocole en cas de crash existentiel. Quel acte poserais-je si j’en venais à envisager le pire ? À qui téléphonerais-je ? L’important, c’est de viser la grande santé. Nietzsche, dans Le Gai Savoir, nous invite à bien faire la différence entre la bonne santé – être sans handicap, sans maladie, sans traumatisme – et la grande santé qui consiste à intégrer, à faire feu de tout bois, à composer avec tout ce qui nous constitue. Ça m’a changé la vie. Avant, je voulais guérir, liquider tout ce qui n’allait pas bien me lançant ainsi dans de vains combats. Aujourd’hui, plus humblement, j’essaie de trouver la joie au cœur du chaos. C’est d’ailleurs ce qu’écrit Nietzsche dans la préface du Zarathoustra : “Il faut encore porter du chaos en soi pour accoucher d’une étoile qui danse”.
--------------------
lundi 19 février 2024
Violence, tensions, micro-agressions : comment apprendre à se préserver
INTERVIEW. Le psychiatre Christophe Massin nous invite à analyser nos propres mécanismes de défense et partage des pistes pour se protéger et « se réconcilier avec soi-même ».
par Alice Pairo-Vasseur (Publié le 16/02/2024) dans Le Point
« Avoir du mal à se défendre n’est pas une fatalité. On peut avoir le sentiment que cela nous dépasse, qu’on ne peut faire autrement, mais la vérité est que chacun peut progresser dans ce domaine », fait valoir le Dr Christophe Massin.
L'attitude délétère d'un proche, le mépris d'un chef, l'agressivité d'un quidam… La nécessité de se défendre et de se faire respecter nous concerne tous. Or nous n'avons pas tous la même capacité à le faire. Pourquoi certains subissent quand d'autres protestent et savent poser leurs limites ? Et comment apprendre à s'opposer et se préserver ? Avec Savoir se défendre – L'immunité psychique (éd. Odile Jacob), le psychiatre Christophe Massin propose une analyse fine et accessible des mécanismes de défense. Il nous invite à observer notre propre fonctionnement, à prendre conscience de nos conditionnements et partage ses pistes pour faire face aux agressions extérieures. Et « se réconcilier avec soi-même ».
Le Point : Vous nous invitez, à travers votre livre, à préserver notre « immunité psychique ». De quoi s'agit-il exactement ?
Christophe Massin : Comme avec l'immunité physiologique, qui nous protège des agressions de toutes sortes (microbiennes, infectieuses…), l'immunité psychique vise à nous défendre de situations (actions, paroles…) qui pourraient nous atteindre et nous perturber sur le plan psychologique. Mon observation part d'un constat clinique : pour m'être occupé de risques psychosociaux en entreprise, j'ai pu observer pendant des décennies combien les personnes qui manquaient de défenses, de limites, pouvaient être maltraitées, exploitées ou écrasées.
Et ce, dans tous les milieux : ouvriers, cols blancs, infirmières, gendarmes… Ces actions ne mettaient pas, à proprement parler, leur vie en danger. Mais elles avaient le pouvoir de les atteindre, de les perturber sur le plan psychique et même, à terme, d'avoir un impact sur leur corps et leur santé (allergies, déficiences immunitaires, maladies auto-immunes…). Préserver son immunité psychique revient donc à distinguer ce qui est bon pour soi de ce qui peut nous faire du tort. Mais aussi à se faire respecter, à poser ses limites et à défendre son intégrité. Comme une sentinelle qui dirait : « Non, ça, je ne laisse pas passer. »
Notre société nous mettrait plus à l'épreuve que jamais, exposez-vous dans votre livre. Expliquez-nous…
Je ne suis pas sociologue et cela mériterait une analyse à part entière. Mais force est de reconnaître qu'une désinhibition des pulsions agressives opère dans notre société. Et le mouvement semble général : les conducteurs de bus, les maires, les médecins, les professeurs. Tous ceux qui travaillent au contact du « public » sont touchés. Les écriteaux de salles d'attente rappelant qu'on doit « respecter la secrétaire », les professeurs qui racontent qu'ils se font insulter par leurs élèves…
Tout cela aurait été inconcevable quelques années en arrière ! Cette agressivité dépasse d'ailleurs nos frontières, le climat de tensions et de crises que l'on observe sur l'ensemble de la planète (réchauffement climatique, conflits…) fait monter les réflexes de peur, donc la violence. Dans cet environnement de plus en plus instable et imprévisible, il est fondamental de s'interroger sur ses ressources. Suis-je prêt à faire face ? Vais-je réussir à ne pas me laisser embarquer ?
Vous pointez aussi les effets délétères d'une agressivité « minimisée », « banalisée »…
Oui, car cette agressivité n'est pas reconnue comme telle, et peut être, de fait, un véritable piège. Plus pernicieuse que l'attaque frontale ou l'insulte, elle est faite de jugements dépréciatifs, de mépris, voire d'une surdité à ce que l'on est. Quand, en réunion, ce supérieur ou ce collègue vous fait une remarque « l'air de rien », ce peut être une flèche, un projectile que vous recevez. Et il est important de ne pas s'y habituer. Cela commence par le fait de le reconnaître et de le nommer puis de le signifier. Cela n'a souvent « pas l'air méchant », mais ce peut être, dans certains cas, un poison : vous êtes déstabilisé, commencez à douter de vous, à culpabiliser…
mercredi 31 janvier 2024
A l'écoute d'Alexandra David Néel
Il y a tout juste 100 ans, Alexandra David-Néel pénétrait incognito dans la ville sainte de Lhassa. En 1969, un mois avant sa mort, Arnaud Desjardins interviewe la célèbre exploratrice qui, centenaire, n’a pas perdu de sa vivacité d’esprit.
dimanche 3 septembre 2023
Colette et l'impermanence heureuse
un interview sur "L'impermanence heureuse" où il est question de Prajnanpad, d'Alzheimer et de Théâtre.
samedi 15 avril 2023
Un rien de qualité
Lors d'une interview de Christian Bobin, le journaliste cite une phrase écrite par le poète, que voici :
jeudi 23 mars 2023
Sourire un instant
Sourire, un état d'esprit... (source de l'interview : revue Reflet)
lundi 6 mars 2023
Engagement de transformation
Nathalie Harar : Quelle est la plus intéressante découverte que vous ayez faite sur vous-même ?
Arnaud Desjardins : Il y en a eu plusieurs et à des époques différentes. En tout cas, au départ, c’est en découvrant l’idée que l’homme fonctionnait comme une machine et qu’il pouvait y introduire plus de conscience, s’engager dans une démarche concrète de transformation, bien au-delà de seulement croire ou de ne pas croire.N.H. : Vers quoi faut-il tendre dans la vie ?
A.D. : Quelques points sont capitaux et je ne les ai d’ailleurs pas inventés. Avoir une connaissance de soi fine. Devenir de plus en plus libre intérieurement. Révéler en nous une profondeur d’être et de conscience qui ne soit pas impliquée dans le vieillissement, la naissance et la mort. En fait, ces idées se retrouvent dans toutes les traditions spirituelles. Ce sont plutôt les méthodes pour y parvenir qui sont variables. J’ai eu l’opportunité de rencontrer des maîtres spirituels soufis, indiens, tibétains… Même avec des chemins et des techniques différentes, le résultat final était là : de ces sages émanaient une même liberté, de la compassion, de l’amour, de la sagesse, et une capacité certaine à être au-delà des formes.
mercredi 7 décembre 2022
lundi 25 juillet 2022
Entretien avec Françoise Hardy
ENTRETIEN AVEC FRANÇOISE HARDY AUTOUR DE L'ASTROLOGIE ET DU SENS (1989-90)
Cet entretien paru dans Nouvelles Clés date de plus de trente ans (fin des années 80). Françoise et moi nous rencontrions alors très régulièrement. Mes pensées vont vers elle aujourd'hui affectée par la maladie (elle ne s'en cache pas) .
L’astre chantant
Gilles Farcet : Vous avez consacré une bonne part de votre énergie à étudier les mécanismes et déterminismes humains. On connaît votre intérêt pour la graphologie et l’astrologie. Comment en êtes-vous venue à vous passionner pour ces disciplines ?
François Hardy: A l’âge de dix-huit ans, sur les conseils de mon médecin, je suis allée voir un astrologue, André Barbault. Je n’y connaissais rien et m’attendais à me faire prédire mon avenir. Lorsque j’ai entendu ce monsieur, que je rencontrais pour la première fois, me parler de mes problèmes personnels, me dire des choses intimes à partir de mon thème, je me suis dit qu’il y avait là quelque chose d’étonnant. Cela fut le point de départ. Plus tard, lorsque j’ai cessé de faire de la scène, j’ai profité de mes loisirs pour suivre des cours d’astrologie. De fil en aiguille, j’ai rencontré Jean-Pierre Nicolas qui m’a proposé de collaborer à une revue qu’il fondait. Par la suite, nous avons animé ensemble une émission astrologique sur RMC. Cette collaboration m’a conduit à étudier son approche de l’astrologie, très différente de celles qui ont cours par ailleurs.
Gilles Farcet : Vous considérez-vous aujourd’hui comme astrologue ?
Françoise Hardy : Oui, tout de même…
Gilles Farcet : Que cherchez-vous à travers l’astrologie?
Françoise Hardy : Au départ, je voulais comprendre un peu plus à qui j’avais à faire, lorsque je rencontrais quelqu’un. C’était un moyen de connaître les autres et aussi, bien sûr, de me connaître moi-même. Avec le temps, je me suis aperçue que les informations astrologiques étaient très limitées : elles n’indiquent en effet que des prédispositions, sans dire ce que le sujet va en faire. Chaque être humain est conditionné par beaucoup d’autres choses que son ciel de naissance. Prenant conscience de ces limites, j’ai eu envie de compléter l’astrologie par autre chose. J’avais songé à la morphopsychologie, puis un heureux concours de circonstances m’a fait rencontrer Christian Dulcy qui m’a convaincu de m’initier à la graphologie. Je continue aujourd’hui de suivre des cours dans cette dernière discipline, qui me paraît être une science extrêmement complexe. Il est, à mon avis, plus difficile d’analyser une écriture que d’analyser un ciel de naissance dans lequel il n’y a guère que les douze signes, les neuf planètes et le soleil. Les combinaisons varient, bien entendu, mais on retrouve toujours un peu les mêmes configurations. Les informations dispensées par le thème restent beaucoup moins précises que celles données par l’analyse graphologique dans laquelle entrent en jeu davantage de paramètres. En contrepartie, le thème est plus facile à manier. La graphologie exige, me semble-t-il, beaucoup plus de compétences, de dons, ou d’années de travail que l’astrologie. Ce qui n’enlève rien à l’intérêt de cette dernière.
Gilles Farcet : L’astrologie est aujourd’hui un business et un milieu dans lequel abondent les querelles d’école, les disputes de chapelle…
Françoise Hardy : Il en a toujours été ainsi. Ces querelles ne m’intéressent guère, mais il est vrai que je suis parfois un peu gênée que l’on connaisse mon intérêt pour l’astrologie dans la mesure où celle-ci n’a pas toujours bonne presse. Nombre de gens se sont, de l’extérieur, fait de cette discipline une idée souvent peu flatteuse. Cela tient sans doute au fait que l’astrologie la plus répandue est assez stupide. Et là, on est bien obligé de se situer, de se réclamer d’une école plutôt que d’une autre, quitte à devoir se montrer très critique à l’égard de certaines approches. Pour ma part, je me rattache donc à l'astrologie dite conditionaliste et suis assez agacée, par exemple, lorsque j’entends des astrologues affiliés à d’autres écoles parler de la lune noire.
Gilles Farcet : Pourquoi?
Françoise Hardy : Parce que la lune noire n’a aucune existence physique ! Jean-Pierre Nicolas promulgue une astrologie sérieuse, fondée sur les réalités astrophysiques du système solaire, cependant que d’autres mettent sur le même plan des planètes qui ont une existence physique et des points fictifs tels que la lune noire. Comment peut-on accorder la même importance, attribuer les mêmes effets à un point fictif et à une planète ? Cela m’apparaît comme une aberration, qui contribue à donner de l’astrologie une image fumeuse, tout à fait fantaisiste. Certaines écoles portent ainsi un tort considérable à l’astrologie car elles mélangent tout et n’ont pas encore saisi la réalité physique des signes du zodiaque.
Gilles Farcet : Que pensez-vous de l’astrologie dite karmique?
Françoise Hardy : Voilà à mon sens un exemple de confusion totale. Le karma est une chose, l’astrologie en est une autre. Tout cela est on ne peut plus flou, approximatif, et il ne saurait en être autrement dans la mesure où l’on ne peut mélanger l’inconnaissable et l’inconnu. C’est à Castaneda que je suis redevable de cette distinction qui me paraît très précieuse. Pour moi, le karma relève et relèvera toujours du domaine de l’inconnaissable, alors que l’astrologie relève encore en partie du domaine de l’inconnu. Par ailleurs, on ne peut parler d’astrologie karmique, puisque des tas de gens naissent en même temps et ont le même ciel de naissance sans avoir pour autant le même karma. Il suffit de considérer le déroulement de leur vie pour s’en apercevoir. Tous les gens qui partagent le même thème que Picasso n'ont pas connu le même destin que lui. Il me semble donc aberrant que l'astrologie, qui est une discipline fondée sur l’observation et l’interprétation de phénomènes physiques, concrets, puisse fournir des renseignements sur ce qui relève de l’inconnaissable.
Gilles Farcet : La pratique de l’astrologie s’inscrit-elle, pour vous, dans le cadre, plus vaste, de ce que l’on pourrait appeler une quête spirituelle ?
Françoise Hardy : Non, mon intérêt pour l’astrologie satisfait plutôt une curiosité quant au fonctionnement de l’être humain. J’aurais, par exemple, tout aussi bien pu faire des études de psychologie. Graphologie, psychologie, astrologie sont des disciplines qui permettent de se mieux comprendre et de mieux comprendre l’autre. Elles aident à cerner le fonctionnement de l'être humain, les règles de ses jeux relationnels. Pour moi, cela n’a rien à voir avec la spiritualité en tant que telle. D’un côté on trouve des sciences ou des approches qui posent la question du “comment ?”, cependant que, de l’autre, la spiritualité soulève l’interrogation plus fondamentale du “pourquoi ?” Non pas “comment fonctionnons-nous dans l’existence ?” mais “pourquoi existons-nous ?” Il s’agit là, me semble-t-il, de deux questions tout à fait différentes.
Gilles Farcet : Qui toutes deux vous intéressent…
Françoise Hardy : Oui, mais s’il est possible d’obtenir des réponses précises dans le domaine du “comment ?”, il n’en va pas de même sur le plan du “pourquoi ?”. Là, les réponses, si réponses il y a, sont toujours aléatoires et font entrer en jeu la croyance, la foi…
Gilles Farcet : Le “comment ?” ne peut-il pas constituer un premier pas vers le "pourquoi ?" Toutes les spiritualités et sagesses préconisent l’étude de nos propres mécanismes. “Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’univers et les Dieux”...
Françoise Hardy : Au-delà du je, j’éprouve un attrait pour les expériences mystiques, pour tous les témoignages qui pointent vers une autre réalité, c’est ainsi que j’ai été très touchée par Les Dialogues avec l’Ange, pour citer un ouvrage connu et typique de ce dont je parle.
Gilles Farcet : Tout à l’heure, vous n’avez cessé de me parler du désir et de la peur ; or, vous êtes tout de même interpellée par une dimension située au-delà du désir et de la peur…
Françoise Hardy : Oui, mais si cette dimension m’intéresse, elle demeure pour moi abstraite. Je n’en ai pas, jusqu’à présent, une expérience concrète.
Gilles Farcet : Cependant vous croyez à son existence ?
Françoise Hardy : Oui et non. En fait, j’ai la foi sur le plan des sentiments mais pas sur le plan intellectuel. Ma raison a toujours besoin de rencontrer des témoignages de ce dont mon cœur est convaincu. En même temps, ma raison livre bataille à mon cœur, elle le taquine en lui disant qu’il n’a cette intuition de Dieu ou de l’au-delà que parce que ça l’arrange, qu’il en a quelque part besoin. J’aimerais être en mesure de prouver à mon intellect que mon cœur est dans le vrai…
Gilles Farcet : Êtes-vous touchée par l’art sacré, le chant grégorien, les icônes ?
Françoise Hardy : En fait, tout ce qui a un relent de religion m’ennuie profondément.
Gilles Farcet : Et si vous alliez séjourner dans un ashram où ont cours certains rites ?
Françoise Hardy : Cela m’ennuierait, à moins que l’on puisse me les justifier d’une manière suffisamment attrayante.
Gilles Farcet : Vous craignez de retomber dans la religiosité de votre enfance ?
Françoise Hardy : Oui, dans la répétition mécanique, les rites auxquels on se soumet sans savoir pourquoi, les prières marmonnées comme un automate… Toutes ces pratiques vides de sens. En fait, vous avez raison quand vous affirmez que l’étude du “comment ?” peut préparer celle du "pourquoi ?" Une grande part de la religion courante frise, me semble-t-il, la débilité mentale et je crois qu’on devrait d’abord étudier la psychologie avant d’en arriver à la religion proprement dite. Beaucoup de gens se tournent vers la religion parce qu’ils ne vont pas bien ; or la psychologie leur serait d’une aide bien plus efficace.
Gilles Farcet : La spiritualité authentique n’est pas destinée aux personnes qui ont déjà bien du mal à faire face à l’existence ordinaire. Elle concerne ceux qui possèdent déjà une certaine structure intérieure. Le maître d’Arnaud Desjardins, Swami Prajnanpad, disait: ” On ne peut pas sauter de l’anormal au supranormal”...
Françoise Hardy : Eh bien, je suis tout à fait d’accord ! Pour les gens qui souffrent, la spiritualité n’est qu’une évasion, une façon d’éluder leurs problèmes.
Gilles Farcet : Vous vous étudiez vous-même, vous décortiquez les mécanismes du quotidien… Qu’en est-il de la politique, d’une autre forme d’engagement en direction de l’extérieur ?
Françoise Hardy : J’admire nombre de chanteurs qui par générosité s’engagent politiquement. Mais pour ma part, je crois que, pour prendre des positions et avoir une action politique, il convient de savoir ce qu’est la politique. Or, j’avoue mon ignorance en cette matière. La politique m’apparaît comme un domaine très complexe, et je trouve aberrant que chacun se mêle de politique sans en avoir les compétences. Les gens, moi la première, discourent, bavardent, sans vraiment savoir de quoi ils parlent. Quelle valeur cela a-t-il ? Sans réelle compétence, on peut se faire piéger par des tas de choses, se faire utiliser, surtout lorsqu’on jouit d’une certaine notoriété. Enfin, j’ai la conviction, qu'en politique comme ailleurs, l’affectif brouille les cartes. Cela est vrai dans tous les domaines, mais cela me paraît particulièrement dangereux sur le plan politique. Nous prenons telle position pour des raisons que nous croyons objectives, alors que notre attitude est entièrement déterminée par l’affectif. C’est un piège très pernicieux. Cet écueil est pratiquement impossible à éviter et ce, même si l’on fait preuve de vigilance. Cela m’incite à la réserve.
Gilles Farcet : L’aisance matérielle, une certaine réussite vous rend-elle plus disponible ?
Françoise Hardy : Bien sûr ! Je suis souvent tourmentée de constater que c’est l’argent qui donne accès à certaines choses : une personne matériellement défavorisée ne pourra guère se permettre de faire une analyse, une thérapie, de s’intéresser à la psychologie et ainsi d’élargir son horizon. L’argent donne aussi du temps, une latitude… Idem pour la spiritualité : aurais-je pu lire Krisnamurti si j’avais dû travailler sans relâche comme ma femme de ménage? J’en doute… Cela dit, chacun a son destin et des personnes bien moins favorisées que d’autres sur le plan matériel peuvent parfois aller beaucoup plus loin… J’ai été bouleversée par les livres de Carlos Castaneda et entre autres par une scène qui se déroule entre l’auteur et Don Juan. Tous deux se trouvent dans une ville mexicain où des enfants affamés se jettent sur des restes de nourriture. Castaneda tient à leur sujet un discours proche de celui que je viens tout juste de tenir. De mon point de vue, sans doute superficiel, ces enfants misérables auront plus de mal à accéder à certains domaines. Quand Castaneda lui parle en ces termes, Don Juan s'insurge et lui renvoie ses propos à la figure en lui expliquant que c’est précisément lui qui est défavorisé, et que ces jeunes gens dépourvus de culture connaissent un accès plus aisé à l’expérience spirituelle concrète. De fait, Don Juan ne se prive jamais de signifier à Castaneda qu’il est particulièrement lent, “bouché”, à cause d’un excès de cérébralisation et de l’influence d’une culture qui tend à raidir, à rigidifier le réel.
Gilles Farcet : Quel est votre désir profond, au-delà des désirs immédiats, même très importants ?
Françoise Hardy : Je souhaite aller vers davantage de disponibilité et davantage de sérénité, les deux étant à mon sens indissociables.
Gilles Farcet : Si vous regardez en arrière, la portion de votre existence qui s’est déjà écoulée a-t-elle pour vous un sens ?
Françoise Hardy : Durant plus de vingt ans, j’ai fait des chansons et je ne le regrette pas. Cela a-t-il un sens ? De toute manière, je n'étais sans doute pas capable de faire autre chose. Certaines de mes chansons sont plutôt bonnes, d’autres sont plus critiquables. En tout cas, ne sachant faire que cela, et dans la mesure où cela me procurait certaines satisfactions, j’ai fait de mon mieux. Au fur et à mesure que je souffrais, des interrogations se sont levées, qui m’ont permis avec l’aide de l’astrologie et de la graphologie, de croître en compréhension. J’espère être un jour en mesure de synthétiser tout ce que j’ai pu entrevoir. Je souhaite pouvoir en faire usage pour moi -même et pour les autres. A différentes époques de ma vie, j’ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m’ont vraiment aidée. Je me souviens ainsi de Mme Godefroy, qui m’a initiée à l’astrologie alors qu’elle était déjà âgée. J’aime à envisager pour moi une vieillesse utile, dans laquelle l’expérience accumulée me permettrait à mon tour, de venir en aide aux autres. Peut-être n’est-ce qu’un idéal… mais j’y tiens.
*********
mardi 5 juillet 2022
Etre ouvert sans projection
mercredi 1 juin 2022
Interview de Gilles Farcet (3)
Frédéric Blanc : Dans ton livre, tu t’attaques à une conception finalement assez matérialiste et bourgeoise de la réalisation spirituelle. L’éveil y est envisagé comme une sorte de droit à la retraite. Après avoir accumulé le nombre de points requis, nous accédons enfin à la béatitude et pouvons nous la couler douce pour l’éternité… De ton côté, tu insistes sur le côté éphémère de toute expérience, y compris celle de « l’Eveil ». La notion hindoue de « jivan mukta » (libéré vivant) était pourtant particulièrement chère à Arnaud Desjardins. Abordée de manière superficielle, cette idée de libération radicale paraît avoir, elle aussi, quelque chose de définitif… N’y a-t-il pas là quelque chose qui peut porter à confusion ?
Gilles Farcet : Mais oui ! La notion si précieuse de « jivan mukta » est délicate et peut facilement prêter à confusion… Surtout en dehors du contexte hindou. Dès qu’on l'aborde, il convient de redoubler de prudence… Je pourrais d’ailleurs tout à fait botter en touche et dire que je n’en sais absolument rien. Mais bon, je vais jouer le jeu… [Silence]… J’aimerais commencer par préciser que je ne remets pas du tout cette perspective en cause. J’y attache même un grand prix ! En dépit de toutes mes réserves, je ne récuse pas la possibilité pour un être humain de s’ouvrir, d’être transpercé, transfiguré et, jusqu’à un certain point, durablement transformé par une dimension d’un autre ordre… Ce que je récuse, en revanche, ce sont les interprétations simplistes d’une réalité qui dépasse très largement notre entendement. Ce dont nous parlons se situe hors du temps et de la forme... Prétendre par exemple que l’Eveil est définitif est aussi absurde que d’affirmer que l’éternité dure longtemps… On confond les niveaux… Je me souviens des cours de catéchisme de mon enfance. Il y était évidemment question de la « vie éternelle ». Cela m’intriguait beaucoup. Je me rappelle avoir fait d’énormes efforts pour comprendre vraiment de quoi il s’agissait. Mais en dépit de toute ma bonne volonté, je finissais toujours par aboutir à une impasse… Plus tard, j’apprendrai le mot « aporie » … En tant que forme humaine, je suis conditionné à me situer dans le temps et l’espace. Par conséquent, tout ce que j’appréhende est limité. Il n’y a donc rien étonnant qu’une réalité dépourvue de début et de fin me soit demeurée inintelligible... [Silence] Je m’élève particulièrement contre l’idée que l’on puisse s’attribuer la réalisation spirituelle. « Je » n’est pas éveillé et ne le sera jamais. L’idée même d’un Eveil personnel est absurde. Cela ne concerne en rien notre pauvre forme relative. Tu parlais d’Arnaud Desjardins… Lorsque Lee Lozowick intervenait à Hauteville, il m’est souvent arrivé de l’entendre prononcer l’une de ses phrases fétiches : « Anyone can fall. » (N’importe qui peut chuter). Arnaud ne s’est jamais précipité sur le micro pour le démentir. Il ne s’est pas écrié : « Non, je ne peux pas te laisser dire ça ! C’est contraire à toute la tradition hindoue etc. ». Si une forme relative peut être plus ou moins transparente à l’absolu, elle ne peut jamais totalement coïncider avec lui. Sinon il n’y aurait plus de forme… Et pour parler plus concrètement, il me paraît très présomptueux de décréter qu’on a atteint ceci ou cela et qu’aucun retour en arrière n'est possible. Comme aurait dit Gainsbourg , « faut voir ! »
Frédéric Blanc : Le dernier chapitre de ta biographie d’Arnaud Desjardins est consacré à la transformation radicale qu’il a subi lors d’un entretien avec son maître. En le relisant, je suis tombé sur la petite phrase suivante : « La peur l’a à jamais quitté. » Tel que tu formules les choses, il semble que cette promesse sidérante concerne directement notre pauvre forme éphémère et qu’elle ait un caractère définitif…
Gilles Farcet : C’est sûr… Oui, cela semble contradictoire… Ne perds pas de vue que ce dont il est question ici dépasse souvent nos capacités de compréhension. En essayant d’en rendre compte, nous n’échapperons ni aux contradictions ni aux paradoxes… Ce n’est d’ailleurs pas une raison pour abandonner tout sens critique… J’invite les lecteurs de cette biographie à réfléchir sérieusement au sens d’une affirmation dont tu fais bien de souligner le caractère étonnant. « La peur l’a à jamais quitté » : qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Est-ce que le corps humain, par exemple, peut vraiment cesser d’avoir peur ? Au moment de son arrestation et de sa mise à mort, le Christ n’en mène pas large. Les Évangiles nous disent qu’il est tellement terrifié qu’il se met à transpirer du sang. Il s’agit apparemment d’un phénomène biologique bien réel. Tout en étant terrorisé, le Christ garde toute sa dignité. A aucun moment, il ne donne l'image d’un homme défait prêt à se renier et abdiquant toute dignité pour sauver sa peau. En soi, c’est déjà un miracle… [Silence]… Je m’intéresse depuis longtemps à la manière dont meurent les hommes. Cette curiosité n’a rien de morbide. Si le sujet retient mon attention c’est que le récit des derniers instants d’un être humain est toujours très significatif. La manière dont se déroulent les choses est bien souvent inattendue et mystérieuse… Le médecin qui a assisté au trépas de M. Gurdjieff rapporte qu’il est mort « comme un roi. » Certaines personnes dépourvues de toute dimension spirituelle consciente partent elles aussi de manière digne et paisible. En revanche on sait que certains grands disciples, voire des instructeurs spirituels reconnus, ont connu une fin plus difficile. Cela ne veut pas dire qu’ils soient morts dans l’indignité et l’abjection. Mais le passage n’a pas été une simple formalité… Je comprends que cette vérité puisse être perturbante. Beaucoup voudraient l’oublier. Pour ma part, je préfère regarder les choses en face. Au stade où j’en suis, je trouve la vérité infiniment plus confortable que le mensonge… [Silence] La pratique spirituelle est précieuse et opérante. Elle peut métamorphoser un destin. Pour autant, elle ne met à l’abri de rien et ne nous garantit certainement pas « la bonne mort » pour reprendre les mots de la tradition chrétienne… J’ai conscience de jouer les équilibristes mais ma prudence et ma propension au paradoxe me semblent plus proches de la vérité que toutes les opinions bien tranchées. La vie est complexe, énigmatique. Le sol s’y dérobe souvent sous nos pieds.
Frédéric Blanc : Il t’arrive d’avoir quelques mots « cruels » envers tous ceux qui s'imaginent trouver ce sol ferme dans la spiritualité. Tu montres combien il est facile de transformer une idéologie spirituelle en une sorte de doudou afin de mettre à distance l’horreur et l’absurdité de la vie. Même l’expérience la plus authentique peut être recyclée par l’ego.
Gilles Farcet : C’est une chose qu’il m’est effectivement arrivé d’observer… Certaines personnes que j’avais rencontrées dans ma jeunesse, et auxquelles j’avais pu attribuer un certain degré de réalisation, m’ont, par la suite, donné l’impression de chuter ou en tout cas de s’empêtrer dans des émotions dont elles paraissaient libres. Je dis cela sans aucun jugement… C’est un simple constat ; un sujet d’étonnement et de réflexion… La vie est un processus de changement permanent. Quels que soient nos « progrès » sur le chemin, nous ne sommes jamais assurés de l’avenir. Peut-être serons-nous ébranlés par un drame qui mettra en lumière des failles dont nous ignorions jusqu’à l’existence. Encore une fois, j’incite à la prudence… En l’absence de cette prudence et de cette humilité élémentaire, il est très facile de nous égarer. Je fais allusion dans le livre à un certain Jeff Foster, un « éveillé » britannique que je n’ai pas rencontré et dont je n’ai jamais lu les livres… Je ne connais de lui qu’une poignée de textes que j’ai trouvé sensibles et assez beaux. Même ceux qui expriment une certaine orthodoxie de l’Eveil m’ont paru être plus profonds que la plupart consacrés au même sujet… Il se trouve que cet encore jeune homme est tombé gravement malade. Suite à cette pathologie il a connu une période de désespoir. Ce que la tradition mystique chrétienne appelle une nuit obscure. Au passage, beaucoup de saints chrétiens font état de moments d’accablement, d’angoisse et de solitude. Après avoir connu les cimes de l’extase, ils se trouvent précipités dans les ténèbres… Bref, Jeff Foster est passé à son tour par cette expérience millénaire et la décrit dans un livre. Sur ces entrefaites, je tombe sur un texte posté sur Facebook. Son auteur, un « éveillé » quelconque, fait la leçon à Jeff Foster en lui disant, qu’à sa place, il ne serait pas passé par les mêmes souffrances. Le tout au nom de l’amour et de la compassion… Cette lecture m’a glacé le sang.
Frédéric Blanc : Passons à un autre de tes textes. Prenons celui que tu as intitulé : Savourer la violence intrinsèque du monde comme un alcool fort… C’est osé comme formule. Pour la majorité des êtres humains, c’est même totalement incompréhensible…
Gilles Farcet : Swami Prajnanpad aimait répéter que l’expérience humaine inclut le meilleur comme le pire. Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment entre incontestablement dans la catégorie du meilleur. Nous nous rencontrons dans une maison belle et agréable. Il fait un temps radieux et nous sommes à priori en bonne santé… Il nous est donné de partager des choses simples mais ô combien précieuses : l’amitié, l’art, la musique, la gastronomie. Que de bénédictions ! Que de privilèges ! Et pourtant, alors même que nous parlons, le monde est saturé de tragédies. Il y a l’Ukraine, bien sûr… Mais ce n’est malheureusement pas le seul endroit où des êtres humains souffrent le martyr… Nous sommes constamment entourés de tragédies ordinaires : le viol, la maltraitance des enfants, celle des vieillards, la maladie, le chômage… La liste est interminable… L'existence humaine est une expérience intégrale, un amalgame improbable de brutalité et de douceur, d’horreur et d’émerveillement, de magie et de médiocrité… Face à des expériences aussi violentes que déstabilisantes, il s’agit de découvrir et de cultiver une certaine vulnérabilité. Il nous est demandé d’accueillir tout ce qui se présente à nous sans pour autant se laisser détruire. Voilà qui n’a rien d’évident.
Frédéric Blanc : Dans le texte intitulé Veiller et prier tu parles de ta rencontre avec Yogi Ramsuratkumar. Cela commence comme un conte de fée. Ce darshan bouleverse à jamais ton existence… La fin du récit n’a cependant rien d’idyllique : « Il avait ainsi été stabilisé en son orbite et cela lui avait coûté cher. » Tu parles ensuite d’années de « plomb ». Ce n’est pas la chute à laquelle on s’attendait.
Gilles Farcet : Il serait évidemment abusif d’établir un lien de cause à effet entre les moments difficiles et parfois déchirants que j’ai pu vivre à un moment de ma vie et ma rencontre avec Yogi Ramsuratkumar. Je veux simplement dire que cette rencontre a marqué un tournant radical dans mon existence. Mon séjour auprès du Yogi semble avoir déposé en moi quelque chose d’irréversible. Tout cela ne m’a pourtant pas empêché de me trouver ensuite confronté à l’aspect “tragique” de l’existence. De là à affirmer que ce voyage en Inde a joué un rôle de catalyseur…
Frédéric Blanc : Mais c’est toi-même qui établit ce lien de cause à effet dans ton texte.
Gilles Farcet : [Silence] Tu as raison… Je ne me l’explique pas clairement mais c’est bien ce qui s’est spontanément imposé à moi… On trouve dans beaucoup de témoignages, l’idée qu’un être humain qui touche à une réalité d’un autre ordre doive ensuite passer par un processus de purification. Cette idée peut paraître morbide ou terriblement moralisante. A mon sens, il faut l’entendre de manière objective, presque technique. Certains parleraient d’accélération du karma…
Frédéric Blanc : Et toi, tu en penses quoi ?
Gilles Farcet : Honnêtement, je n’en sais rien. On ne compte plus les personnes qui vivent des situations difficiles voire terribles. Rares sont celles qui ont l’idée de parler d’accélération du karma. Ceux qui adhèrent à une idéologie spirituelle ont parfois tendance à magnifier leur vécu. Ils parlent alors de “Karma”, de “purification”… On pourrait simplement y voir la faute à pas de chance… La réalité étant toujours complexe, il est également vrai que les événements ont la signification qu’on veut bien leur accorder. En ce qui me concerne, j’ai tenté de tirer profit des épreuves par lesquelles je suis passé. Au lieu de m’aigrir et de me fermer, j’ai essayé d’en émerger plus vulnérable, plus sensible, plus mûr. Enfin j’espère…
Frédéric Blanc : La notion de service revient avec insistance dans ton livre. Deux questions pour clore cet entretien : Qu’est-ce que servir ? Quelle forme ce service prend-t-il dans ta vie quotidienne ?
Gilles Farcet : Servir, c’est se consacrer de manière unifiée et innocente à une situation dans laquelle on se trouve impliqué. C’est jouer le rôle qui nous est imparti au moment et dans les circonstances où il nous est imparti… C’est agir de manière aussi peu égocentrique que possible. Plutôt que de me mettre exclusivement au service de mes propres intérêts, j’essaie de me mettre au service de l’ensemble de la situation. Je vais illustrer ce point par l’un de ces exemples bébêtes que j’affectionne… Un conducteur qui fait de son mieux pour respecter les règles du code de la route se met au service de la conduite. Il est conscient d’être l’un des éléments d’un ensemble qui inclut non seulement son véhicule, ses passagers éventuels mais aussi les autres conducteurs, les piétons, ainsi que les bestioles de tous poils susceptibles de faire irruption sur la route… L’ego a pour sa part un style de conduite immédiatement reconnaissable. Il est le contrôleur et le possesseur de Sa route. Il roule trop vite ou trop lentement, s’énerve, prend des risques inutiles… [Silence]... Comment est-ce que je m’efforce de traduire tout cela en actes ? Comme tout un chacun, je remplis différentes fonctions : j’essaie d’être un père, un mari, un citoyen… Le rôle auquel je consacre le plus de temps et d’énergie est celui d’instructeur, d’ami spirituel au sens large… A quoi sert un instructeur ? Le rôle d’un instructeur est d’accompagner les personnes qui le sollicitent - toutes celles qui ne lui demandent rien devant être laissées tranquilles ! En tant qu’instructeur, j’aide mes élèves à voir leurs inévitables résistances et difficultés. Je suis au service de leur mutation, de leur maturation. Je sers leur personne, non de leur ego. J’ajouterais enfin que je m’occupe d’elles de manière individuelle tout en tenant compte de la dynamique de groupe dans laquelle elles sont insérées… Voilà la manière dont j’essaie de servir… Chacun occupe une fonction. Le maire du village, l’épicier, le cantonnier, l’institutrice… Toutes ces fonctions ont leur importance. La mienne n’est pas plus illustre qu’une autre. Elle est simplement plus rare, plus inhabituelle. La valeur de notre fonction dépend moins de sa nature que de la manière dont nous essayons de l’incarner. En agissant comme nous le faisons participons-nous à la guérison ou à la maladie du monde ? De qui ou de quoi nous faisons-nous les serviteurs ?
------------------------
mardi 31 mai 2022
Interview de Gilles Farcet (2)
Frédéric Blanc : Revenons à ton dernier livre. Dans quel genre littéraire le classerais-tu ?
Gilles Farcet : Je le classerais spontanément dans le genre de la confession. Précisons que je n’emploie pas ce mot dans son sens pénitentiel… Il ne s’agit pas d’un aveu mais d’un partage profond et intime. C’est en quelque sorte mon petit « coming-out mystique ».
Frédéric Blanc : J’aurais également parlé de poésie…
Gilles Farcet : Tout à fait. Même s’ils sont rédigés en prose, ces textes touchent à l’écriture poétique.
Frédéric Blanc : En France, les milieux littéraires et spirituels s’ignorent quand ils ne se méprisent pas. N’y a-t-il pas quelque risque à écrire un livre qui relève de ces deux genres antagonistes ?
Gilles Farcet : C’est un risque assumé mais finalement très relatif… Quelles que soient ses qualités littéraires, il est clair que ce texte s’adresse en premier lieu à des personnes sensibles à la dimension spirituelle. Je pense qu’un partage de ce genre est susceptible de nourrir leur aspiration… J’ignore sincèrement s’il pourrait intéresser un public purement littéraire… Mais comme ce n’est pas mon propos, je ne me pose pas vraiment la question. Dans la mesure où beaucoup de textes littéraires possèdent une dimension que l’on pourrait qualifier de spirituelle, on pourrait arguer que l’opposition entre ces deux univers a quelque chose de factice… Il n’en reste pas moins vrai que cet antagonisme existe et qu’il n’est pas près de disparaître… J’ai par exemple été très frappé par le fait que les éditions récentes du Mont Analogue de René Daumal, ne comportent plus la dédicace à Alexandre de Salzmann, son premier instructeur dans les groupes Gurdjieff… Puisque René Daumal est mort depuis longtemps, on se doute bien que ce n’est pas lui qui est à l’origine de cette suppression. Mais alors qui ? On pourrait certes affirmer qu’on a enlevé le nom d’Alexandre de Salzmann parce qu’il n’est pas connu du grand public. Beaucoup de livres d’écrivains célèbres sont dédiés à de parfaits inconnus ; cela n’empêche pas le nom de ces anonymes de continuer à figurer sur la page de garde. A tort ou à raison, je soupçonne que la disparition de cette dédicace est le signe d’une gêne, d’un malaise du milieu littéraire vis-à-vis d’un objet littéraire à la dimension spirituelle trop flagrante.
Frédéric Blanc : Ton livre n’est pas uniquement une création personnelle. Il comporte un grand nombre de photos de Christian Petit. La présence de ces belles images enrichit sa lecture…
Gilles Farcet : Yes ! Merci de le mentionner.
Frédéric Blanc : Pourquoi ce choix ?
Gilles Farcet : C’est une idée de l’éditeur. Lorsque je lui ai soumis le texte, il m’a proposé de le publier dans une collection illustrée. J’ai immédiatement pensé aux photos de mon ami Christian dont j’apprécie la finesse du travail. Je suis heureux qu’il ait accepté.
Frédéric Blanc : « L’être heureux est une personne » … Voilà qui sonne très chrétien…
Gilles Farcet : Absolument ! Plus j’avance en âge (et, espérons-le, en maturité), plus ma sensibilité spirituelle prend une coloration chrétienne. C’est d’autant plus paradoxal que je ne me suis jamais tellement intéressé à la religion en tant que telle… Je parle ici de toutes les religions : l’hindouisme ne captive pas plus que le christianisme, le bouddhisme ou le judaïsme. Enfant, j’étais touché par l’enseignement des Évangiles. Le quotidien d’un maître entouré de ses disciples me bouleversait… Le reste m’a très tôt paru bizarre et déroutant… Ce qui me passionne encore aujourd’hui, c’est la dimension verticale. On en trouve évidemment la trace fulgurante dans les Évangiles mais aussi dans une certaine mystique chrétienne. Je ne parle pas seulement de Maître Eckhart et autres mystiques subtils et sublimes qu’il est de bon ton de citer dans les milieux non-dualistes. Je suis tout aussi touché par des saints beaucoup moins ésotériques comme Saint Vincent de Paul ou le Curé d’Ars.
Frédéric Blanc : Qu’est-ce qui te touche dans la sensibilité chrétienne ?
Gilles Farcet : C’est peut-être l’insistance sur la notion de personne. De ce point de vue, la culture chrétienne est aux antipodes de l’hindouisme et du bouddhisme.
Frédéric Blanc : Venant de quelqu’un qui insiste sur la dimension impersonnelle de son livre, tu avoueras que c’est piquant…
Gilles Farcet : C’est sûr ! (Rires) Ce genre de paradoxe est cependant inévitable… Il est pour moi évident que même la dimension la plus impersonnelle ne peut être vécue que dans une forme c’est à dire par une personne. On se demande d’ailleurs bien comment il pourrait en être autrement… Ce vécu n’a rien à voir avec son histoire, sa psychologie, ses conditionnements divers et variés et pourtant… Et pourtant, c’est bien un être humain unique qui va vivre de manière subjective une expérience que l’on pourrait qualifier d’objective. A mon sens, on touche là au mystère de la personne. Qu’est-ce qu’une personne au sens chrétien du terme ? On dit que Dieu est une personne… Qu’est-ce que ça veut dire ? Il m’est d’autant plus impossible de répondre à cette question que je ne suis pas théologien… Ce dont je suis certain, c’est qu’il existe un mystère et une sacralité de la personne… Note que la dimension de la personne dépasse de loin notre personnalité psychologique… A quoi tient notre singularité ? Elle n’est pas seulement le fruit de notre histoire. Beaucoup d’histoires se ressemblent d’ailleurs… L’expérience d’un garçon traumatisé par la naissance d’un frère cadet s’apparente à celle de millions d’autres enfants. Et pourtant chacun de nous est radicalement unique. Cette énigme se laisse entrevoir dans les visages. Lorsque je passe par Londres, il m’arrive souvent de visiter la National Portrait Gallery. Cela me fascine. Les êtres humains sont façonnés selon un nombre limité de types physiques et psychologiques et pourtant, on ne rencontre jamais deux fois le même visage. Aucun regard ne ressemble tout à fait à un autre. Cette singularité radicale est désormais corroborée par la science. Nos empreintes digitales et notre ADN sont absolument uniques. C’est vertigineux quand on y pense ! [Silence] Autre paradoxe : même si elle insiste énormément sur la dimension de la personne, la sensibilité chrétienne ne met jamais l’individu en avant. Il serait inconcevable pour un saint chrétien de se vanter d’avoir atteint la sainteté. Le christianisme nous met inlassablement en garde contre l’orgueil spirituel. Il n’en va pas de même pour certains « éveillés » qui se réclament pourtant d’une tradition non dualiste…
Frédéric Blanc : Tu t’en prends à ce que tu appelles « leur version des faits ». Qui sont ces gens dont tu remets en cause la vision du monde ?
Gilles Farcet : C’est une bonne question… Je suis conscient qu’il y a un brin de paranoïa dans cette expression… Du coup nous abordons une thématique un peu plus personnelle… (sourire) « Leur version des faits », désigne cette conception pauvre et plate de la réalité qui de tout temps a tenu le haut du pavé... En quoi consiste-t-elle ? Cette vision des choses se caractérise par sa mesquinerie et son manque absolu de perspective : le réel est linéaire, prévisible… La vie se réduit à un morne combat qui se gagne à coup de calculs miteux… Je ne suis pas en train de nier l’évidence. Oui, il existe des lois physiques, sociales, psychologiques etc. A un certain niveau, on peut même dire qu’elles nous gouvernent de manière implacable… Si cet aspect des choses est loin d’être anecdotique, il n’en reste pas moins partiel. Quelque chose d’autre est à l’œuvre. Quelque chose d’infiniment plus mystérieux qui échappe à toute tentative de conceptualisation. Et pourtant, c’est cette dimension insaisissable qui régit et gouverne la réalité. Je ne récuse pas « Leur version de faits », j’en souligne simplement l’étroitesse.
Frédéric Blanc : A tes yeux, « leur version des faits » semble inclure des idéologies parfaitement incompatibles. Tu y inclus pêle-mêle : « Dieu, pas Dieu, le Parti, la Révolution, le Conservatisme, les Valeurs, l’Insoumission, l’Anarchisme, la Tradition etc. » J'imagine qu’un communiste orthodoxe rechignerait à admettre qu’il partage la même « version des faits » qu’un catholique intégriste ou un chantre de l’économie néo-libérale... Qu’est-ce qui les rapproche selon toi ?
Gilles Farcet : Ce qui les rapproche, c’est leur identification totale à une idéologie. Celle-ci peut être religieuse, comme le christianisme, politique et économique, comme le communisme ou le capitalisme libéral. Je ne prétends pas que ces idéologies soient entièrement néfastes ou inutiles… Si je ne suis pas marxiste, je ne considère pas non plus que le communisme se réduise à un tissu d’inepties. La lutte des classes n’est pas une invention de Marx ! De là à dire que ce soit l’unique moteur de l’histoire… Toute idéologie digne de ce nom, je ne parle ici pas des discours extrémistes dont j’ai une sainte horreur, est porteuse d’une part de vérité. Toutes entrevoient un aspect de la réalité. Les problèmes commencent à partir du moment où l’on prétend ériger une philosophie en dogme et où l’on s’imagine qu’elle est capable de rendre compte de la totalité du réel. Ce genre de réductionnisme est toujours l’expression d’une peur.
Frédéric Blanc : Est-il possible à un être humain de se libérer complètement de ses conditionnements idéologiques ? Un esprit mal tourné pourrait par exemple te faire remarquer que ton discours relève d’une idéologie spiritualiste…
Gilles Farcet : Tu as raison. J’ai un certain regard sur le monde que l’on peut qualifier de spiritualiste. Toute la question est alors de voir si mon « spiritualisme » m’empêche de comprendre, pourquoi pas d’apprécier pour leurs qualités, un matérialiste récusant toute dimension spirituelle, ou un militant qui ne voit de sens que dans l’engagement politique. En tant que forme, je ne crois pas que l’être humain puisse totalement échapper aux conditionnements. Être vivant équivaut toujours à être sous influence… Avancer qu’une forme pourrait être intégralement non conditionnée me paraît absurde. On affirme volontiers que les grands sages vivent libres de tout conditionnement. A un certain niveau, d’accord… Il n’empêche que de manière plus ordinaire, en tant que formes, c’est à dire en tant qu’êtres humains, ils demeurent dans une certaine mesure le produit de leur culture, de la société dans laquelle ils ont grandi et évoluent. Toute la différence, et elle change tout, réside dans la relation qu’ils entretiennent avec ces conditionnements relatifs. Pour le dire simplement en prenant un exemple que j’ai bien connu, Arnaud Desjardins n’était pas prisonnier d’une mentalité bourgeoise et protestante. Et cependant, il restait reconnaissable en tant qu’homme de sa génération issu d’un certain milieu.
.................................