« Lorsque ce qui nous distingue de l’animal s’impose absolument, cela devient aussi ce qui nous sépare de Dieu. » (K.G. Durckheim - Le maitre intérieur)
Autre livre, autre propos : « Si l’homme est bien destiné à
devenir un être pensant, cela se faisant, il oublie d’où il vient ». Ces propos
ne peuvent qu’interroger sur le sens que nous donnons à notre existence, notre
intelligence, notre humanité ?
L’être humain a deux approches du réel à sa disposition :
une approche par la pensée et une approche par la sensation. Deux approches
qui, chez l’homme adulte, au lieu de se compléter, s’opposent ou ne font plus
qu’une, la pensée rationnelle étouffant de plus en plus la conscience
sensitive.
Nous commençons notre existence dans une relation sensorielle au monde.
Depuis les premières impressions dans le ventre de la maman
jusqu’aux années de la petite enfance, nous baignons dans une conscience en
contact direct avec le réel : pas de noms pour nommer ce que nous sentons,
voyons, entendons, faisons … pas de comparaisons, pas d’oppositions entre ceci
ou cela.
J’ai été récemment surpris par la qualité des oui et des non
de ma petite-fille âgée de 18 mois ; pas des « oui mais … » pour faire plaisir,
pour suivre des convenances, ni des « non » de rejet définitif ou de réaction.
Rien que des réponses sans aucune rigidité ni à-priori, claires et unifiées de
tout son être ; réponses qui, dans l’instant, n’opposent rien à rien et peuvent
évoluer au gré des circonstances.
Cette approche directe et sensorielle du réel ne passe pas
encore par le filtre de la pensée analytique ou discursive. Elle est propre à
l’homme comme à l’animal, car nous sommes tous à l’origine des « êtres doués de
vie », étymologie du mot animal.
L’être humain, lorsqu’il quitte ces premières années
d’existence, est ensuite amené à développer une autre approche du réel : c’est
le développement de la pensée et de l’intelligence conceptuelle. Une évolution
tout à fait naturelle et justifiée pour s’insérer dans la société des humains
et maitriser au mieux son existence.
Mais, cette approche du réel finissant par « s’imposer
absolument », c'est-à-dire partout et tout le temps, nous nous coupons de nos
racines, du lien qui fait de nous des êtres vivants, universellement vivants.
Retrouver ce lien est la raison d’être du zen.
Ce que nous accumulons, fixons, vivons avec notre conscience
conceptuelle nous coupe du geste d’être, du sentiment d’appartenance « à la
Grande Vie ».
C’est alors « que nous nous séparons de Dieu », ou, pour le
dire autrement, de l’Essence insaisissable de notre humanité.
La Voie nous éveille au fait que l’aspiration légitime à une
existence assurée et maitrisée, si nous n’y prenons garde, finit par s’opposer
à la vérité que « Tout ce qui est vivant ne vit que par le devenir » et qu’ainsi,
« protégé par la carapace d’un moi qui le tient prisonnier, l’Homme se ferme à
l’élan vital transformateur de son être essentiel.» K.G.Durckheim
Notre véritable essence ne peut se dévoiler que si nous renonçons à tout vivre par le prisme de la pensée, et que nous nous ré-ouvrons à une relation directe et sensorielle avec le réel. C’est un réapprentissage de l’expérience d’être, la simple joie d’être, pouvant nous illuminer à la faveur d’un moment particulier, nous faire sentir passagèrement cette réalité : « Qu’il est bon de se sentir vivre ! »
Le zen est un retour aux sources de l’intelligence naturelle
dont l’homme est issu et fait encore partie, quel que soit son degré
d’évolution intellectuelle, son compte en banque ou sa fonction dans le monde.
Quel paradoxe ! Pour nous rapprocher à nouveau de notre
complétude humaine, nous devons nous défaire de ce que nous avons appris à
mettre en avant pour nous distinguer de l’animal : la raison conceptuelle.
Un exemple : nous partageons avec le monde animal une même
faculté d’attention : voir, goûter, entendre, sentir … sans analyse de ce qui
est vu, goûté, entendu, senti. Nous avons perdu cette qualité originelle de
présence, et des expressions telles que « pleine attention ! », « vigilance ! »
sont souvent mal comprises sur la Voie, synonymes d’un travail sur soi
volontaire et autoritaire : « - Je dois sans arrêt faire attention ! » Mais
attention à quoi ?
A ce que la conscience rationnelle ne prenne pas tout
l’espace et libère la pleine sensorialité, la pleine attention naturelle propre
au corps vivant.
Cet état de présence à soi et au monde, ouvert et perméable,
est notre état naturel d’attention, qui réapparait lorsqu’il n’est pas mis en
veilleuse par la prédominance de la pensée : nous pouvons alors être surpris de
re-sentir, re-voir, ré-entendre vraiment ce que nous pensions connaitre parce
que nous le nommions ou le classifions.
Cela demande de reprendre au sérieux le monde sensoriel
pré-mental, de prendre au sérieux le rappel de « tout faire un tout petit peu
plus lentement ».
Ainsi, dans la pleine attention au geste vital, source de
toute action, laissons-nous surprendre et transformer par ces moments plus
habités qui nous touchent et nous arrêtent dans notre frénésie quotidienne
d’efficacité et d’accumulation.
Les expressions de notre vraie nature, les « touchers de
l’être », interrogent sans cesse et très concrètement notre humanité par notre
manière d’être au monde.
Joël PAUL
-----------













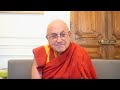











Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire