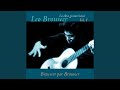Le péché serait-il tabou ? Ou ne serait-il qu'un terme obsolète, juste bon à nous culpabiliser de façon mortifère ? Si l'on se réfère à sa racine hébraïque, le mot « péché » signifie manquer son but, se tromper de cible. La cible ? Notre bonheur, lequel ne peut être atteint qu'en Dieu. Pécher équivaut donc à se tromper de bonheur. Le péché affecte notre relation à Dieu, à l'autre, à nous-même. Parfois lié à nos blessures psychologiques, le péché n'en demeure pas moins un acte libre. Rencontre avec Pascal Ide, auteur du livre les Sept Péchés capitaux ou ce mal qui nous tient tête (Mame).
Revenons sur la définition du péché capital...
Souvent, nous confondons péché capital et péché grave ou mortel (qui prive l'âme de la vie divine). Ainsi, la gourmandise est rarement un péché grave. Pourtant, on la compte parmi les péchés capitaux. Revenons à l'étymologie. Capital vient du latin caput « la tête ». Ainsi, le péché capital est un péché qui est à la tête d'autres péchés. C'est-à-dire qu'il en engendre beaucoup d'autres. Nous ne commettons pas spontanément un meurtre. Mais celui-ci vient d'un péché plus originaire, comme la colère ou la jalousie. Pour reprendre l'exemple de la gourmandise : celui qui n'est pas tempérant dans la nourriture, manque souvent de sobriété dans d'autres domaines, la parole, etc. On comprend donc que lutter contre un péché capital, c'est aller à la source, c'est couper les racines de nos péchés.
Vous expliquez dans votre livre que pécher revient à se tromper de bonheur...
C'est vrai du péché capital, mais c'est aussi vrai du péché en général. Derrière chaque péché, se cache une idole nous faisant croire à un vrai bonheur. Or, seul Dieu peut répondre à notre soif d'infini et nous combler. Pécher, c'est idolâtrer une créature, au lieu du Créateur. Il y a en effet une façon d'aimer son travail, son conjoint, son sport, son enfant, qui le place au-dessus de tout. Dès lors, le centre de nos vies n'est plus Dieu, mais ce à quoi nous sacrifions tout. Au fond, saint Augustin l'avait bien vu, le choix ultime se joue entre Dieu et nous : le péché est toujours une préférence de soi.
Le péché est-il un acte libre ?
Il l'est par définition. Sinon, nous n'avons pas affaire à un péché mais à une erreur, ou à une blessure.
Est-on véritablement libre lorsque notre acte ou pensée mauvais a été provoquée par une blessure intérieure ?
Tout conditionnement, comme une blessure ou un trait d'éducation, amoindrit la liberté et donc excuse l'acte pécheur. Pour autant, il ne l'annule pas. Mille conditionnements ne font pas un déterminisme. Si, dans ma famille on mentait ou médisait, j'aurais tendance à minimiser ces péchés. Mais, d'abord, je peux constater que lorsqu'on ment sur moi ou qu'on détruit ma réputation, je me sens blessé. Cela me permet de comprendre que lorsque je fais la même chose à l'autre, je détruis la relation de confiance. Ensuite, j'ai à former ma conscience morale, par exemple, en lisant la troisième partie du Catéchisme de l'Église catholique. Prenons un autre exemple. Quelqu'un dont l'éducation délétère aurait été telle qu'on l'aurait toujours comparé à autrui : « Regarde ton petit frère, il est plus gentil que toi », « Regarde ton voisin, lui au moins réussit bien dans ses études », etc. Comment cette personne ne serait-elle pas soumise à la tentation de la jalousie ? Mais, même si je suis tenté, une liberté en moi restera préservée. Non pas celle de ne pas ressentir cette tristesse qu'est la jalousie, mais celle de l'entretenir, ou non, en pensée, de l'actualiser par des critiques, et a fortiori par le rejet de l'autre.
Garde-t-on cette part de liberté en cas d'addiction ?
L'addiction se définit par cette perte du contrôle de la liberté : la personne alcoolique ne peut pas ne pas ressentir son besoin de boire, et, si elle est en présence d'alcool, ne pas succomber. Mais il faut ajouter que la liberté n'est pas annulée. Pour refuser la tentation victimaire, il s'agit de considérer les domaines où la liberté peut s'exercer. Ici, sur trois points. Il s'agira d'abord de reconnaître que je suis dépendant, et donc de cesser de me tromper moi-même parce que j'ai des périodes de sobriété. Puis, d'aller faire un bilan pour connaître les conséquences de cet alcoolisme sur ma santé, mon entourage. Enfin, de prendre les moyens pour me traiter.
Les péchés capitaux se situeraient donc à la frontière entre le psychologique et le spirituel ?
Tout à fait, et c'est ce qui fait leur spécificité. Si je suis blessé dans mon estime de moi, je vais davantage mettre en avant mon ego, et je serai par conséquent particulièrement tenté par l'orgueil. Il y a en chacun de nous des racines de péchés capitaux. Nous sommes tous un jour jaloux, gourmands, colériques. Mais nous sommes loin de commettre tous des meurtres ou des adultères. Autrement dit, les péchés capitaux correspondent aux grandes inclinations de l'âme qui, lorsqu'elles sont démesurées, deviennent pécheresses.
En quoi celui qu'on appelle le « démon » peut-il interférer ?
Le démon est le prince du déséquilibre. Il utilise nos failles. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il est important de guérir le plus possible d'un point de vue psychologique : guérir lui donne moins de prises sur nous.
............