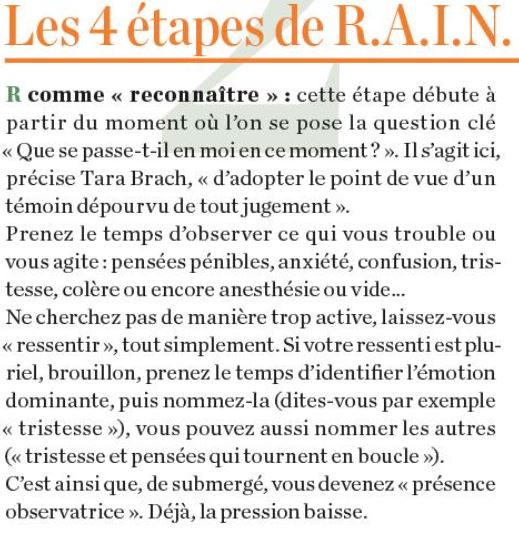Écologie, technique, ère de la « propagande » : Jacques Ellul avait-il anticipé les travers de notre époque ?
Tour d’horizon des principaux thèmes sur lesquels le monde actuel semble, hélas ! donner raison à la pensée d’Ellul.
Par Sixtine Chartier
Et si Jacques Ellul avait (presque) tout prévu ? C’est un journaliste du Canard enchaîné, Jean-Luc Porquet, qui l’affirme, dans un livre paru en 2003 au Cherche Midi. Lister les prévisions d’Ellul est une entreprise risquée, car la relecture a posteriori est propice aux biais de confirmation. Sans aller jusqu’à en faire un prophète – statut revendiqué pour nombre d’autres penseurs du passé –, ses grandes thématiques éclairent des logiques encore à l’œuvre dans notre société.
La critique de la technique
Clé de voûte de son œuvre, l’analyse du phénomène de la technique est sans doute le plus grand apport d’Ellul à la compréhension du monde d’aujourd’hui. Son premier livre, paru en 1954, mais rédigé entre 1948 et 1950, la Technique ou l’Enjeu du siècle, annonce la couleur. « Pour Ellul, ce ne sont pas les idéologies qui vont primer mais la technique, décrypte Frédéric Rognon, spécialiste du penseur, professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. C’était inaudible à l’époque, mais aujourd’hui personne ne peut le nier. »
À l’aube des Trente Glorieuses, période d’accélération de la modernisation, Ellul révèle en effet la place centrale des techniques dans les sociétés modernes. Il n’est pas le seul, comme le souligne l’historien François Jarrige dans La modernité dure longtemps (Éditions de la Sorbonne, 2020), citant d’autres penseurs et écrivains comme Bernanos (la France contre les robots, 1947) ou le sociologue Georges Friedmann. « Ellul conteste la thèse de la neutralité de la technique, explique Frédéric Rognon. Il montre qu’elle est ambivalente. Tout progrès produit à la fois et de façon indissociable des effets positifs en termes de rapidité, d’efficacité, de confort… et en même temps des effets catastrophiques, comme des destructions des libertés et de la qualité de vie. »
Face aux innovations, Ellul nous invite donc à peser le pour et le contre avant de s’y engager. À l’heure des prouesses de l’intelligence artificielle ou des manipulations génétiques du vivant, cette invitation est plus que jamais d’actualité.
Un précurseur de l’écologie
Cette critique du « système technicien » dans lequel le monde semble aujourd’hui enferré mène tout droit à la pensée écologique. Ellul est souvent considéré comme un des précurseurs de l’écologie. « C’est à lui que l’on doit la formule : “On ne peut pas concevoir un développement infini dans un monde fini”, indique Frédéric Rognon. Son premier texte écologique date de 1935. À cette époque, il critique le modèle américain du productivisme et de la standardisation qui s’installe en Europe, tout en constatant que le régime soviétique emprunte le même chemin. Alors que le monde intellectuel français s’enflammait pour l’un ou l’autre de ces modèles, il estime que le problème réside plus profondément dans l’accélération du progrès technique. Il en appelle déjà à la sobriété. »
La pensée englobante d’Ellul prédit un chaos généralisé au niveau planétaire du fait de la conjonction des crises environnementales, financières, internationales et sanitaires. Lucidité factice de la pensée du pire ? L’actualité semble malheureusement encore une fois donner raison à Ellul.
L’ère de la « propagande »
Ce sont peut-être les travaux de Jacques Ellul qui sont les plus prémonitoires. Il adopte une définition large en désignant « une propagande horizontale, qui ne vient pas forcément d’un pouvoir politique autoritaire, mais se transmet les uns par les autres », explique Frédéric Rognon.
Pour le professeur à Sciences Po Paris David Colon, auteur de Propagande. La manipulation de masse dans le monde contemporain (Belin, 2019), les analyses d’Ellul sont d’une actualité frappante. Il cite son livre de 1962 (Propagandes) : « En réalité, la multiplicité des informations n’éclaire nullement le lecteur et l’auditeur, mais le noie. Il ne peut ni les retenir dans sa mémoire, ni les coordonner en système, ni les expliquer : s’il ne veut pas risquer de devenir fou, il est obligé d’en retirer une image globale. Et cette image sera d’autant plus simpliste que le nombre de faits qu’on aura fourni aura été plus grand. » Une phrase qui semble écrite pour notre époque, à l’heure des réseaux sociaux.
---------------source : La Vie